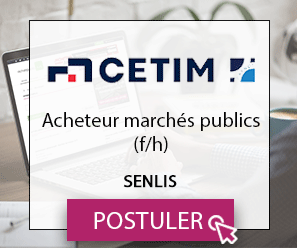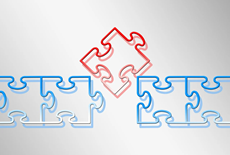Un club pour les acheteurs publics responsables
- 22/03/2011
Déjà fondateur d’un club des acheteurs privés responsables, l’Institut du management des achats (IMA) du pôle universitaire Léonard de Vinci récidive, cette fois pour les acheteurs publics. La première rencontre, le 16 mars, a notamment porté sur les marchés réservés de l’article 15, objet d’une étude du réseau Gesat.
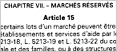
Ils étaient une vingtaine de professionnels à avoir répondu présents, le 16 mars, pour le lancement du club des acheteurs publics responsables dans les locaux de l’Institut de management des achats, installé au cœur du pôle universitaire Léonard de Vinci près de l’Arche de la Défense. Directeur du MBA délivré par l’école, Arnaud Salomon a, en effet, décidé de lancer un cercle « public » à l’image de ce qui existe déjà pour le privé, avec une cinquantaine de grandes sociétés qui ont planché autour d’un référentiel (1). Comme leurs confrères des entreprises, les agents publics sont invités à réfléchir à un référentiel plus spécifique à leur secteur, composé de tableaux de bord, matrices et indicateurs : part du chiffre d’affaires achats confié au secteur adapté et protégé, part des heures travaillées grâce aux clauses d’insertion, impact des clauses sur la concurrence, attractivité des marchés réservés, etc. En résumé, un outil capable de choisir, de mesurer et de piloter, a expliqué en substance Ludovic Myhie, professeur associé à l’IMA et consultant chez CKS. Le club, qui se veut une structure légère (pas de frais d’adhésion), se réunira tous les trimestres sur des thématiques particulières, témoignages et retours d’expériences à l’appui (2). A l’occasion du lancement, les marchés de l’article 15 ont fait l’objet d’un focus. Responsable des partenariats et de la formation au réseau GESAT (groupement national des entreprises et services d’aide par le travail), Farid Ben Malek a présenté les résultats d’une étude, laquelle a répertorié les avis de publicité ad hoc passés sur le BOAMP entre juillet 2010 et février 2011. Soit environ 400 marchés passés en très grande partie par les collectivités locales (73%), très loin devant l’Etat (11%), les hôpitaux (8%) et les organismes de sécurité sociale (8%), et concentrées dans certaines régions (20% des avis en région francilienne, 10% dans le Nord-Pas-de-Calais, 8% en Aquitaine).
La publicité pose problème
 Si elle n’a pas de valeur scientifique (il n’y a pas d’obligation à publier au BOAMP en dessous de 90 000 euros et s’agissant de l’Etat, la publication sur la plate-forme interministérielle est gratuite), l’enquête met en relief plusieurs problèmes récurrents. Le premier souci, pour l’entreprise adaptée, c’est de repérer le besoin des pouvoirs adjudicateurs. D’autant que les marchés réservés sont souvent de faible montant, avec par conséquent un choix de supports de publicité très large. L’échantillon GESAT le rappelle : 19% des avis recensés pèsent moins de 4000 euros, 55% oscillent entre 4000 et 90 000 euros. Seuls 26% dépassent les 90 000 euros. Le BOAMP ? A priori difficile d’y retrouver ses petits. 80% des avis recensés par le GESAT comprenaient le mot-clef « atelier protégé », terme qui n’est plus en vigueur depuis 5 ans, alors que les termes « marché réservé » ou « entreprise adaptée » demeurent très peu employés par les rédacteurs des pièces. « Le résultat, c’est que la grande majorité des EA-ESAT est susceptible de passer à côté du marché », alerte Farid Ben Malek. De plus, les directeurs de structure ne consultent pas ce site naturellement, ajoute le représentant du réseau qui plaide pour sa chapelle, « objectivement le meilleur support ». Le GESAT, qui répertorie des avis et les envoie aux directeurs d’établissements tous les dix jours, communique aussi par mél les « demandes formalisées » qu’on lui adresse. Un service gratuit pour ses partenaires, et facturé au tarif BOAMP pour les autres.
Si elle n’a pas de valeur scientifique (il n’y a pas d’obligation à publier au BOAMP en dessous de 90 000 euros et s’agissant de l’Etat, la publication sur la plate-forme interministérielle est gratuite), l’enquête met en relief plusieurs problèmes récurrents. Le premier souci, pour l’entreprise adaptée, c’est de repérer le besoin des pouvoirs adjudicateurs. D’autant que les marchés réservés sont souvent de faible montant, avec par conséquent un choix de supports de publicité très large. L’échantillon GESAT le rappelle : 19% des avis recensés pèsent moins de 4000 euros, 55% oscillent entre 4000 et 90 000 euros. Seuls 26% dépassent les 90 000 euros. Le BOAMP ? A priori difficile d’y retrouver ses petits. 80% des avis recensés par le GESAT comprenaient le mot-clef « atelier protégé », terme qui n’est plus en vigueur depuis 5 ans, alors que les termes « marché réservé » ou « entreprise adaptée » demeurent très peu employés par les rédacteurs des pièces. « Le résultat, c’est que la grande majorité des EA-ESAT est susceptible de passer à côté du marché », alerte Farid Ben Malek. De plus, les directeurs de structure ne consultent pas ce site naturellement, ajoute le représentant du réseau qui plaide pour sa chapelle, « objectivement le meilleur support ». Le GESAT, qui répertorie des avis et les envoie aux directeurs d’établissements tous les dix jours, communique aussi par mél les « demandes formalisées » qu’on lui adresse. Un service gratuit pour ses partenaires, et facturé au tarif BOAMP pour les autres.
Une vision dépassée des prestations du secteur protégé
Deuxième souci : une vision archaïque de l’offre. D’après l’étude, les acheteurs commandent en priorité aux EA-ESAT du traitement des espaces verts (25%), de la papeterie et des fournitures de bureau (21%), et des produits d’entretien (12%), en fait « des commandes de sacs poubelle », précise-t-il. Or, le panorama des prestations est bien large, du call-center à la traduction, en passant par la gestion de réseaux informatiques. La restauration collective fait partie du lot. « Cela existe mais cela n’est pas connu », poursuit Farid Ben Malek qui illustre son propos avec deux sites dans le Rhône et le CNFPT qui a choisi une entreprise adaptée pour le restaurant de son nouveau siège à Paris. Le bouche à oreille débloque souvent la situation. « Un hôpital de l’AP-HP a proposé à un ESAT de gérer sa cafétéria parce qu’il savait qu’un autre établissement le faisait déjà ». Pourtant, le décalage est « dommageable », regrette-t-il. L’allotissement est aussi un bon moyen de sortir des sentiers battus. La région Poitou-Charentes a ainsi réservé à un ESAT la distribution de son magazine sur un seul département. La situation pourrait évoluer, notamment grâce au possible alignement sur le privé, à terme, du mode de calcul des déductions possibles, via les contrats passés avec des EA ou des ESAT, à la contribution versée au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) lorsque l’organisme ne respecte pas le quota d’emplois (6%). Pour l’instant, la collectivité a la chance de récupérer le montant total des factures réellement acquitté TTC. « L’entreprise privée valorise uniquement la prestation de main d’œuvre. Dans le cas de l’achat de ramettes de papier, elle ne peut déduire que la participation réelle de l’ESAT, soit le conditionnement. »
Calibrer le besoin pour éviter l’infructueux
Troisième hic : le calibrage du besoin. Il s’avère indispensable de rencontrer les entreprises en amont pour bien comprendre leur fonctionnement. Une règle qui vaut pour tous les achats, encore plus s’agissant du secteur protégé. Le nombre potentiel de travailleurs affiché est souvent trompeur. « Un handicapé psychique, compté pour une personne, ne sera présent qu’un tiers ou un quart de temps », signale Farid Ben Malek. Idem pour l’encadrement. « Si quatre moniteurs sont absents, ce sont quatre équipes qui ne sont plus opérationnelles. » Du coup, une entreprise adaptée peut avoir un carnet de commandes rapidement rempli. La plate-forme achats francilienne du Commissariat général des armées peut en témoigner à propos d’un marché d’espaces verts. Malgré une dizaine d’acteurs directement sollicités, un avis sur la plate-forme interministérielle et le site spécialisé Handeco, seules deux offres avaient été finalement déposées (3). Etre à côté de la plaque, c’est faciliter l’infructueux. Jamais une entreprise adaptée ne fera cent kilomètres pour tondre une pelouse. « Au point de vue développement durable, c’est ridicule. Et c’est générateur de maltraitance pour des personnes handicapées », prévient Cheick Elola, directeur de l’ESAT La Brèche à Saumont-La-Poterie (Seine-Maritime). Inutile aussi de se délester de prestations que les entreprises traditionnelles répugnent à prendre en charge. « C’est dégradant. Si personne n’en veut, pourquoi les personnes handicapées le feraient ? », s’offusque-t-on au GESAT.
(1) Lire notre article : Un référentiel sur les achats responsables
(2) Pour en savoir plus et assister aux rencontres du club : event@ima-devinci.com , en précisant dans l'objet du message "inscription club achat public responsable"
(3) Lire notre article : Le Commissariat des armées met au point des clauses-types socialement responsables
Sur le même sujet


Envoyer à un collègue
Acheteur marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
Gestionnaire marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
- 10/09/2025
- Ville d'Argenteuil
TA Polynésie française 28 juillet 2025 EURL Ha'aviti
-
Article réservé aux abonnés
- 19/09/25
- 07h09
TA Mayotte 29 juillet 2025 Préfet de Mayotte
-
Article réservé aux abonnés
- 18/09/25
- 07h09
TA Paris 21 juillet 2025 Centre Régional de Formation Professionnelle
-
Article réservé aux abonnés
- 17/09/25
- 07h09
Rendez-vous à 9h00 pour notre "direct" : achatpublic invite... Simon Uzenat
-
Article réservé aux abonnés
- 10/09/25 11h09
- Jean-Marc Joannès
Marché public : une offre incomplète n’est pas systématiquement irrégulière
-
Article réservé aux abonnés
- 11/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Marché public : un candidat admissible à la négociation... évincé
-
Article réservé aux abonnés
- 12/09/25
- 06h09