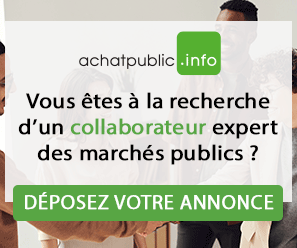Entreprise en difficulté, un titulaire comme les autres
Maître David Taron, avocat au barreau de Paris, décrypte pour nous l’instruction du 26 janvier 2012 relative au traitement des procédures collectives intervenant en cours d’exécution des marchés publics. L’objectif du texte est de faire prendre conscience que les entreprises en difficultés ne sont pas des canards boiteux, mais des titulaires normaux.
La perspective d’avoir comme titulaire un « canard boiteux » suscite des réticences chez la très grande majorité des pouvoirs adjudicateurs. C’est ainsi que la candidature d’une entreprise à l’égard de laquelle est mise en œuvre une procédure collective est généralement appréhendée avec beaucoup de circonspection. Il en va de même lorsqu’une entreprise connaît des difficultés au cours de l’exécution d’un marché. Or, on oublie que le droit des procédures collectives vise avant tout à rétablir la situation économique des entreprises, ce qui constitue un objectif des plus légitimes en période de crise. A cette aune, il est donc contreproductif d’empêcher les entreprises en difficulté d’exécuter des marchés, surtout si on considère que la commande publique, du fait de la solvabilité des personnes publiques (on doit encore y croire !), peut constituer un vecteur de revitalisation. C’est dans ce contexte que le ministère du Budget a publié une instruction, le 26 janvier dernier (instruction n°12-005-M0 ; NOR : BCR Z 12 00007 J), afin de rappeler aux comptables publics que la mise en œuvre d’une procédure collective n’est pas antinomique avec l’exécution d’un marché public. Au-delà de ce public averti, ce texte présente un intérêt certain en ce qu’il permet de préciser les attitudes que doivent adopter les pouvoirs adjudicateurs concernant la poursuite des relations contractuelles et le règlement des comptes en fin de marché. Classiquement, il invite à distinguer les hypothèses de redressement judiciaire des cas de liquidation judiciaire en en précisant les conséquences (on rappellera ici que lors de sa saisine, le tribunal de commerce peut soit rendre un jugement prononçant le redressement judiciaire soit, s’il n’existe aucune perspective de redressement, rendre un jugement prononçant sans délai la liquidation judiciaire de l’entreprise).
Le redressement judiciaire n’empêche pas la poursuite de l’exécution
Lors d’une mise en redressement judiciaire, il est constaté que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en cessation des paiements. L’entreprise est alors généralement placée en période d’observation et un administrateur judiciaire est désigné. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Dans ces conditions, il est donc logique que l’entreprise puisse exécuter les contrats en cours. C’est ce que rappelle l’instruction en question en précisant toutefois qu’une contrainte procédurale pèse sur le pouvoir adjudicateur, à savoir l’obligation d’adresser une mise en demeure à l’administrateur judiciaire, lequel doit décider, dans un délai d’un mois, de la poursuite du contrat. En cas de réponse positive de ce dernier, le contrat ne peut pas être résilié à l’initiative du pouvoir adjudicateur, sauf à risquer d’engager sa responsabilité (CE, 24 octobre 1990, Régie immobilière de la Ville de Paris, n°87237). Même si l’instruction ne le mentionne pas, on peut rappeler qu’en cas de réponse négative de l’administrateur judiciaire, le marché doit être résilié sans indemnisation, ainsi que le prévoit l’article L. 622-13 du code de commerce. On peut également mentionner que, au cours de la période d’observation, le pouvoir adjudicateur doit déclarer les créances qu’il estime avoir sur son titulaire (pénalités de retard par exemple). Les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce imposent à cet égard une déclaration auprès du mandataire judiciaire. Ainsi que l’indique l’instruction du 26 janvier 2012, c’est au comptable public qu’il appartient de procéder aux déclarations de créances (Cass. com., 29 avril 2003, n°00-14142). A l’issue de la période d’observation, plusieurs scénarii sont possibles : soit l’entreprise se redresse et continue son activité ; soit ses actifs sont cédés en tout ou partie (on parle alors de plan de cession) ; soit elle est placée en liquidation judiciaire. Dans le premier, les marchés continuent à être exécutés, sans aucune difficulté. Dans le deuxième cas, les marchés sont de plein droit transférés au cessionnaire (à la condition, en cas de cession partielle, que les marchés en cause soient liés aux activités reprises). L’instruction précitée souligne à juste titre que la cession opérée ne s’inscrit pas dans le cadre fixé par le Conseil d’Etat dans son avis du 8 juin 2000, mais repose sur l’article L. 642-7 du code de commerce. Le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas s’y opposer puisqu’il s’agit d’un mécanisme légal (CAA Nancy, 26 janvier 2006, Jean-Pierre Y. n°00NC01239). Bien entendu, il pourra prononcer la résiliation du marché dans l’intérêt du service s’il apparaît que le cessionnaire n’est pas en mesure d’en assurer l’exécution (ce que confirme une réponse ministérielle n°12644 : JOAN Q, 5 octobre 1998).
Liquidation judiciaire : la survie de l’entreprise
Dans le cas d’une liquidation judiciaire (troisième hypothèse), un liquidateur est désigné et procède à l’apurement du passif (autant que faire se peut) avant complète dissolution. Pendant cette période, l’entreprise est réputée survivre pour les besoins de sa liquidation. Les marchés publics ne prennent donc pas immédiatement fin. Comme le rappelle l’instruction du 26 janvier 2012, le jugement de liquidation judiciaire doit être envoyé au pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur doit alors adresser au liquidateur une mise en demeure de se prononcer sur la poursuite de l’exécution du contrat, ce dans un délai d’un mois. Si le liquidateur estime que l’exécution du contrat peut être poursuivie, il ne peut pas y avoir légalement de résiliation à l’initiative du pouvoir adjudicateur, sauf là encore à risquer d’engager sa responsabilité. Si au contraire le liquidateur considère que l’entreprise n’est effectivement plus en mesure d’honorer ses obligations, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, et ce sans indemnisation. La résiliation ne peut donc pas être de plein droit, ainsi que le dispose l’article L. 641-11-1 du code de commerce. En cas de résiliation, il convient bien entendu d’établir le décompte du marché afin d’en solder définitivement les comptes. Le titulaire a alors droit au paiement des diligences qu’il a réalisées antérieurement à la résiliation, déduction éventuellement faite des avances versées par le pouvoir adjudicateur. L’instruction du 26 janvier 2012 permet de le constater, le droit des procédures collectives conduit à traiter les entreprises en difficulté titulaires de marchés comme des cocontractants presque « normaux », ce qui va à l’encontre de nombre d’idées reçues.
Instruction n°12-005-M0 du 26 janvier 2012 relative aux marchés publics et procédures collectives
Le redressement judiciaire n’empêche pas la poursuite de l’exécution
Lors d’une mise en redressement judiciaire, il est constaté que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en cessation des paiements. L’entreprise est alors généralement placée en période d’observation et un administrateur judiciaire est désigné. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Dans ces conditions, il est donc logique que l’entreprise puisse exécuter les contrats en cours. C’est ce que rappelle l’instruction en question en précisant toutefois qu’une contrainte procédurale pèse sur le pouvoir adjudicateur, à savoir l’obligation d’adresser une mise en demeure à l’administrateur judiciaire, lequel doit décider, dans un délai d’un mois, de la poursuite du contrat. En cas de réponse positive de ce dernier, le contrat ne peut pas être résilié à l’initiative du pouvoir adjudicateur, sauf à risquer d’engager sa responsabilité (CE, 24 octobre 1990, Régie immobilière de la Ville de Paris, n°87237). Même si l’instruction ne le mentionne pas, on peut rappeler qu’en cas de réponse négative de l’administrateur judiciaire, le marché doit être résilié sans indemnisation, ainsi que le prévoit l’article L. 622-13 du code de commerce. On peut également mentionner que, au cours de la période d’observation, le pouvoir adjudicateur doit déclarer les créances qu’il estime avoir sur son titulaire (pénalités de retard par exemple). Les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce imposent à cet égard une déclaration auprès du mandataire judiciaire. Ainsi que l’indique l’instruction du 26 janvier 2012, c’est au comptable public qu’il appartient de procéder aux déclarations de créances (Cass. com., 29 avril 2003, n°00-14142). A l’issue de la période d’observation, plusieurs scénarii sont possibles : soit l’entreprise se redresse et continue son activité ; soit ses actifs sont cédés en tout ou partie (on parle alors de plan de cession) ; soit elle est placée en liquidation judiciaire. Dans le premier, les marchés continuent à être exécutés, sans aucune difficulté. Dans le deuxième cas, les marchés sont de plein droit transférés au cessionnaire (à la condition, en cas de cession partielle, que les marchés en cause soient liés aux activités reprises). L’instruction précitée souligne à juste titre que la cession opérée ne s’inscrit pas dans le cadre fixé par le Conseil d’Etat dans son avis du 8 juin 2000, mais repose sur l’article L. 642-7 du code de commerce. Le pouvoir adjudicateur ne peut donc pas s’y opposer puisqu’il s’agit d’un mécanisme légal (CAA Nancy, 26 janvier 2006, Jean-Pierre Y. n°00NC01239). Bien entendu, il pourra prononcer la résiliation du marché dans l’intérêt du service s’il apparaît que le cessionnaire n’est pas en mesure d’en assurer l’exécution (ce que confirme une réponse ministérielle n°12644 : JOAN Q, 5 octobre 1998).
Liquidation judiciaire : la survie de l’entreprise
Dans le cas d’une liquidation judiciaire (troisième hypothèse), un liquidateur est désigné et procède à l’apurement du passif (autant que faire se peut) avant complète dissolution. Pendant cette période, l’entreprise est réputée survivre pour les besoins de sa liquidation. Les marchés publics ne prennent donc pas immédiatement fin. Comme le rappelle l’instruction du 26 janvier 2012, le jugement de liquidation judiciaire doit être envoyé au pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur doit alors adresser au liquidateur une mise en demeure de se prononcer sur la poursuite de l’exécution du contrat, ce dans un délai d’un mois. Si le liquidateur estime que l’exécution du contrat peut être poursuivie, il ne peut pas y avoir légalement de résiliation à l’initiative du pouvoir adjudicateur, sauf là encore à risquer d’engager sa responsabilité. Si au contraire le liquidateur considère que l’entreprise n’est effectivement plus en mesure d’honorer ses obligations, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, et ce sans indemnisation. La résiliation ne peut donc pas être de plein droit, ainsi que le dispose l’article L. 641-11-1 du code de commerce. En cas de résiliation, il convient bien entendu d’établir le décompte du marché afin d’en solder définitivement les comptes. Le titulaire a alors droit au paiement des diligences qu’il a réalisées antérieurement à la résiliation, déduction éventuellement faite des avances versées par le pouvoir adjudicateur. L’instruction du 26 janvier 2012 permet de le constater, le droit des procédures collectives conduit à traiter les entreprises en difficulté titulaires de marchés comme des cocontractants presque « normaux », ce qui va à l’encontre de nombre d’idées reçues.
Instruction n°12-005-M0 du 26 janvier 2012 relative aux marchés publics et procédures collectives


Envoyer à un collègue
Nouveaux documents
TA Lyon 4 juin 2025 Société Computacenter France
-
Article réservé aux abonnés
- 31/07/25
- 07h07
TA Strasbourg 17 juin 2025 SAS Houpert
-
Article réservé aux abonnés
- 30/07/25
- 07h07
TA Bastia 20 juin 2025 SARL Corse Propreté 1 and Co
-
Article réservé aux abonnés
- 29/07/25
- 07h07