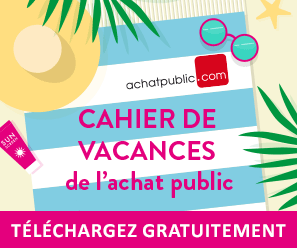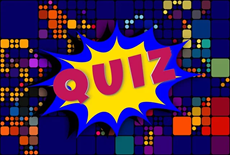Organiser sa défense
Comment se défendre une fois le recours formé ? En commençant par se trouver un bon avocat et en rassemblant toutes les pièces du marché contesté. Au publiciste ensuite, à la lumière de ces documents et du contexte dans lequel le contrat a été passé, de rédiger un mémoire en défense solide. Tout se joue avec ce mémoire car c’est sur la base de ce dossier et de celui de l’entreprise requérante que le juge administratif rendra sa décision. Aucun nouvel argument sur le fond de l’affaire ne pourra être invoqué dans une requête en appel en CAA ou un pourvoi en cassation au conseil d’Etat.L’une des premières choses à faire lorsque la machine contentieuse est en marche consiste, bien évidemment, à organiser sa défense. En effet, une fois le recours formé, la collectivité attaquée va devoir se faire assister d’un avocat pour sa contre-offensive. Jusqu’à présent, le choix du défenseur se faisait de manière intuitu personae en fonction de critères propres à la personne publique tels que, par exemple, le prix des honoraires, la notoriété de l’avocat, sa disponibilité, sa localisation, etc. Mais la donne a changé avec l’entrée en vigueur du code des marchés publics 2006 et la nouvelle rédaction de l’article 30 relatif aux services soumis à un régime assoupli : « Il faut désormais mettre en concurrence la prestation de représentation en justice. Les délais de mise en concurrence paraissent compatibles avec les recours au fond, mais pas avec celui du référé précontractuel pour lequel on ne sait pas précisément ce qu’il en est », mentionne Jean-Philippe Lévy, avocat pour le cabinet De Castelnau (lire notre article sur le choix d’un avocat). Rassembler toutes les pièces du marchéAfin de constituer le mémoire en défense, le publiciste a besoin de toutes les pièces du dossier relatif à la passation du marché contesté et de connaître les éléments du contexte : « Ces documents, en particulier le PV d’analyse des offres, permettent souvent de répondre à bien des griefs du requérant et de démontrer, le cas échéant, que le choix de la personne publique était justifié », explique Jean-Philippe Lévy. Alors que l’entreprise dispose en général de deux mois pour introduire un recours, la collectivité visée a - en théorie - tout son temps pour organiser sa contre-attaque, sauf bien sûr en cas de référé. On s’en doute, le délai nécessaire pour constituer le mémoire en défense est très variable : cela dépend de la nature du recours introduit, mais également du degré de complexité du contrat mis en cause et des moyens soulevés par l’entreprise : « si les griefs soulevés sont stéréotypés, un mémoire peut prendre 48 heures pour un référé précontractuel et 1 à 2 mois pour un recours au fond », indique l’avocat. Instruction close après les échanges de mémoiresUne fois le mémoire en défense constitué et envoyé à la partie adverse ainsi qu’au juge, la collectivité reçoit la « réplique » de l’entreprise. Elle dispose alors d’un délai fixé par le magistrat pour y répondre qui est en général de 60 jours. Est alors rédigé le second mémoire en défense, suivi de la « duplique » du requérant : « Dans la plupart des cas, ça s’arrête là, il n’y a pas de nouvelles navettes », précise Jean-Philippe Lévy. Dès lors, le juge clôt l’instruction et arrête la date d’audience au cours de laquelle les avocats des parties adverses pourront plaider. Contrairement aux procédures pénales, il n’est pas possible en droit du contentieux administratif de soulever à l’oral d’autres arguments que ceux présentés dans les différentes écritures, cependant : « l’audience permet d’insister sur les points essentiels que l’on veut mettre en exergue auprès du juge », explique le spécialiste. Seule exception à la règle : le référé précontractuel. Les délais de cette procédure étant très courts (le juge ne peut suspendre la signature du contrat que pendant vingt jours), l’avocat peut continuer oralement à avancer ses arguments pendant l’audience et l’on considère que l’instruction est définitivement close à la fin de la séance. Au tribunal administratif - la première instance sollicitée dans un contentieux - le délai qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est généralement compris entre 7 mois et deux ans et demi. Décision rendue dans les 15 jours après l’audienceLa présence de la collectivité et de son avocat n’est pas indispensable en audience pour un recours au fond. Toutefois, il est souvent utile d’être présent, en particulier pour écouter les conclusions du commissaire au gouvernement, qui prend la parole en dernier, une fois que les avocats ont plaidé. Une fois l’audience terminée, le juge rend généralement sa décision dans les 15 jours. Les parties ont alors deux mois pour faire une requête en appel auprès de la cour administrative si la décision du tribunal administratif n’est pas satisfaisante. Là encore, le référé précontractuel fait exception : la décision du magistrat est très rapide puisqu'il est tenu par la délai des 20 jours et en cas de contestation, il n’y a pas de passage par la case de la cour administrative d’appel (CAA). L’ordonnance fait directement l’objet d’un pourvoi en cassation au conseil d’Etat. Le jugement d’une affaire suit le même processus en CAA qu’en TA : rédaction du mémoire en défense, réplique, re-mémoire en défense et duplique. Le requérant n’aura pas la possibilité de développer de nouveaux moyens au fond, mais il pourra présenter les arguments juridiques tendant à montrer en quoi la juridiction précédente a mal jugé le litige. La requête devra donc être nécessairement accompagnée du jugement du TA. A ce stade, le délai moyen pour obtenir la décision est un plus longue. Il faut compter entre un et deux ans et demi selon la cour. Le pourvoi en cassation : une voie de droit exceptionnelleDernière marche possible pour contester une décision juridique : celle menant au conseil d’Etat. Dans ce cas, seul un avocat du conseil d’Etat est autorisé à plaider devant les sages du Palais Royal. Le requérant devra donc en choisir un pour se faire assister. Survivance de l’ancien régime, pour devenir avocat au conseil d’Etat, il faut en effet acheter une charge, après avoir suivi une scolarité au sein de l’institut de formation des avocats du conseil d’Etat et avoir été coopté par l’un des 60 avocats du conseil d’Etat. « Les publicistes qui ne possèdent pas cette charge et qui ont travaillé sur un dossier jusqu’en CAA proposent généralement à leur client le nom de l’un de ceux qu’ils connaissent bien et avec qui ils ont l’habitude de travailler », commente Jean-Philippe Lévy. Lorsqu’il est saisi d’une affaire, le conseil d’Etat ne va pas la rejuger. Il se contente de vérifier le respect des règles de procédure et la correcte application du droit par les juges du fond. Le jugement ou l’arrêt n’est annulé que si la procédure a été irrégulière ou les règles de droit mal appliquées. A ce stade ultime, le délai moyen qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est d’environ un an. Sandrine Dyckmans © achatpublic.info, le 01/11/2006



Envoyer à un collègue
Juriste commande publique (f/h)
- 31/07/2025
- Amiens Métropole
Juriste commande publique (h/f)
- 16/07/2025
- CA Saint Germain Boucles de Seine
Responsable affaires juridiques et commande publique (h/f)
- 16/07/2025
- CA Saint Germain Boucles de Seine
TA Lyon 4 juin 2025 Société Computacenter France
-
Article réservé aux abonnés
- 31/07/25
- 07h07
TA Strasbourg 17 juin 2025 SAS Houpert
-
Article réservé aux abonnés
- 30/07/25
- 07h07
TA Bastia 20 juin 2025 SARL Corse Propreté 1 and Co
-
Article réservé aux abonnés
- 29/07/25
- 07h07
Attributaire d’un marché public de second rang : un intérêt à agir en référé ? Le juge se positionne !
-
Article réservé aux abonnés
- 31/07/25 06h07
- Mathieu Laugier
Quiz API 2025 : une remise en questions estivale
- 01/08/25 06h08
- Mathieu Laugier
Marchés publics et 3 devis : une problématique dépassant le Code de la commande publique ?
-
Article réservé aux abonnés
- 13/03/25 06h03
- Mathieu Laugier
Six critères environnementaux testés dans l’achat public de médicaments
-
Article réservé aux abonnés
- 30/07/25 06h07
- Hubert Heulot