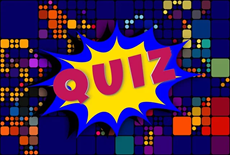Délit de favoritisme : les agents entre le marteau et l’enclume
- 11/07/2011
Pas d’infraction à son insu en matière de favoritisme. L’intentionnalité réside dans l’acte accompli, pas dans la conscience de violer la loi. C’est que rappellent Eric Dezeuze et Thierry Dal Farra, tous deux avocats à la cour de Paris, à propos de ce délit. Face à une illégalité, l’agent doit désobéir, sous peine d’être complice aux yeux du juge.

Instrument fort de la moralisation de la vie économique, le délit de favoritisme, ou plus exactement délit d’octroi d’un avantage injustifié, fait peur. Il hante les esprits des élus locaux et des agents publics alors que les infractions sont finalement rares et les condamnations exceptionnelles. Il faut dire que son caractère intentionnel le rend redoutable. Plusieurs rapports ou projets législatifs ont préconisé, ces dernières années, de dépénaliser au moins l’intentionnalité du délit, au motif qu’il tétanise les acheteurs. C’est le cas notamment du rapport Stoléru sur l’accès des PME aux marchés publics ou encore du projet de loi de réformes des juridictions financières proposant de soumettre à la Cour des comptes les actes de favoritisme non intentionnel. Mais jusqu’à présent, rien n’a abouti, en raison notamment du poids hautement symbolique de cette infraction. En attendant une éventuelle réforme, les acheteurs doivent garder en tête que leur responsabilité peut être engagée s’ils font partie d’une chaîne de décisions où le délit serait constaté. Et ce, même s’ils n’ont rien fait. C’est ce qu’ont rappelé Eric Dezeuze, un spécialiste du droit pénal des affaires, et Thierry Dal Farra, spécialiste en droit public, tous deux  avocats à la cour de Paris, à l’occasion d’un débat sur le sujet proposé par Yann Aguila, conseiller d’Etat, qui s’est tenu au palais de justice de Paris le 23 juin dernier : « L’intentionnalité, ce n’est pas la conscience de violer la loi, mais l’acte accompli. Et nul n’est censé ignorer la loi. Peu importe que l’on ait conscience ou pas de l’acte délictueux, la seule conscience exigée, c’est de passer un ordre, ce sont les actes », a prévenu Eric Dezeuze. S’y ajoute le fait que « c’est le méli-mélo concernant la définition des personnes concernées par le délit, complète Thierry Dal Farra. Toute personne « qui agit pour le compte de » peut être concernée, ce qui veut tout dire et rien dire. Son champ d’application est large », déplore-t-il.
avocats à la cour de Paris, à l’occasion d’un débat sur le sujet proposé par Yann Aguila, conseiller d’Etat, qui s’est tenu au palais de justice de Paris le 23 juin dernier : « L’intentionnalité, ce n’est pas la conscience de violer la loi, mais l’acte accompli. Et nul n’est censé ignorer la loi. Peu importe que l’on ait conscience ou pas de l’acte délictueux, la seule conscience exigée, c’est de passer un ordre, ce sont les actes », a prévenu Eric Dezeuze. S’y ajoute le fait que « c’est le méli-mélo concernant la définition des personnes concernées par le délit, complète Thierry Dal Farra. Toute personne « qui agit pour le compte de » peut être concernée, ce qui veut tout dire et rien dire. Son champ d’application est large », déplore-t-il.
Entre le marteau et l’enclume
L’attitude passive est source d’incrimination. Une personne qui sait et qui ne fait rien est complice aux yeux du juge. Et une délégation de signature ne change rien à l’affaire : « Si une personne sait et n’agit pas, sa connaissance des faits scelle sa complicité, même en cas de délégation de signature. Le favoritisme est un délit supposant une action personnelle. Il n’y a pas de responsabilité pénale délégable. C’est une atteinte à l’autorité  de l’Etat, à l’administration et un manque au devoir de probité », confirme Eric Dezeuze. Impossible pour les édiles et les responsables administratifs de se démettre de leur responsabilité. Ils doivent donc se montrer vigilants pour éviter les mauvaises surprises. Le sort des agents publics n’est pas plus enviable. Coincés entre le marteau et l’enclume, ils ont le devoir d’obéir à leur hiérarchie, sauf dans deux cas de figure précis définis à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public », est-il écrit. « Un fonctionnaire n’a qu’une seule alternative : obéir ou désobéir. S’il se trouve face à une illégalité, il doit désobéir », assène Maître Del Farra.
de l’Etat, à l’administration et un manque au devoir de probité », confirme Eric Dezeuze. Impossible pour les édiles et les responsables administratifs de se démettre de leur responsabilité. Ils doivent donc se montrer vigilants pour éviter les mauvaises surprises. Le sort des agents publics n’est pas plus enviable. Coincés entre le marteau et l’enclume, ils ont le devoir d’obéir à leur hiérarchie, sauf dans deux cas de figure précis définis à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public », est-il écrit. « Un fonctionnaire n’a qu’une seule alternative : obéir ou désobéir. S’il se trouve face à une illégalité, il doit désobéir », assène Maître Del Farra.
En faire une infraction disciplinaire
Le problème, c’est que pour désobéir, il faut être certain de son coup, sous peine de voir peut-être sa carrière compromise pour avoir accusé à tort un supérieur... « La situation de l’agent est claire et injuste », résume l’avocat. Ce dernier signale également le risque que représente le cumul d’une infraction pénale et d’une faute de service. Gare, par exemple aux primes reçues pour le travail effectué pour un marché : « Un agent qui reçoit une prime pour un marché qui s’avère corrompu risque le recel », indique-t-il. Car, comme le souligne Eric Dezeuze: « Tous les cas de complicités passives sont, aux yeux du juge, des coactions ». Le spécialiste, tout comme son confrère, s’accordent à dire que l’incrimination large de ce délit et l’étendue de son champ d’application le rendent trop répressif à l’heure actuelle et génèrent de l’insécurité juridique : « Il faudrait instaurer un dol spécial, en particulier concernant le caractère intentionnel de la faute », suggère Eric Dezeuze. « La disparition complète de l’infraction proposée dans le rapport Stoléru était une erreur, estime pour sa part Thierry Dal Farra. Il serait plus approprié d’en faire une infraction disciplinaire, jugée devant la cour de discipline budgétaire et financière. Et prévoir des sanctions obstacles, telles que par exemple l’interdiction à vie de signer des marchés et de dépenser des deniers publics en cas de corruption avérée pour les élus et l’interdiction d’être acheteur public pour un agent. La difficulté, c’est qu’une telle proposition implique de reconnaître le métier d’acheteur et ses spécificités. Il faudrait également mieux définir les règles de déontologie des élus et des fonctionnaires », complète-t-il. Le sujet pourrait connaître des rebondissements. Thierry Dal Farra a, en effet annoncé au cous du débat, qu’il compte déposer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel à l’occasion d’un prochain cas de délit de favoritisme.


Envoyer à un collègue
Responsable de service commande publique et achats (f/h)
- 13/08/2025
- Ville de Fontenay-sous-Bois
Gestionnaire marchés publics (f/h)
- 13/08/2025
- Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles
Juriste commande publique (f/h)
- 31/07/2025
- Amiens Métropole
TA Lyon 4 juin 2025 Société Computacenter France
-
Article réservé aux abonnés
- 31/07/25
- 07h07
TA Strasbourg 17 juin 2025 SAS Houpert
-
Article réservé aux abonnés
- 30/07/25
- 07h07
TA Bastia 20 juin 2025 SARL Corse Propreté 1 and Co
-
Article réservé aux abonnés
- 29/07/25
- 07h07
Quiz API 2025 : une remise en questions estivale
- 01/08/25 06h08
- Mathieu Laugier
Marchés publics et 3 devis : une problématique dépassant le Code de la commande publique ?
-
Article réservé aux abonnés
- 13/03/25 06h03
- Mathieu Laugier
Attributaire d’un marché public de second rang : un intérêt à agir en référé ? Le juge se positionne !
-
Article réservé aux abonnés
- 31/07/25 06h07
- Mathieu Laugier
[Tribune] « L'arrêt de la CAA de Nantes sur les 3 devis ? Une vision passéiste et dépassée de la commande publique ! »
-
Article réservé aux abonnés
- 06/03/25 06h03
- Jérôme Michon
[Interview] Luc Brunet : «Poursuites et condamnations des gestionnaires publics ? Un nouveau record à venir !»
-
Article réservé aux abonnés
- 10/07/25 06h07
- Mathieu Laugier