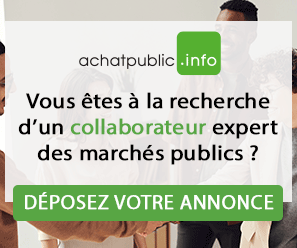Une commande publique « SMART » : oui, mais encore ?

« Tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l'est pas est inutilisable »
Paul Valéry
SMART, pour "Sue", "Mesurable", "Acceptée", "Réalisable" et "temporellement définie"». Un sigle mémotechnique que les managers connaissent surtout pour les aider à définir une politique RH efficace. Sauf que là, ce sont aussi les conditions que Yorick Guinebert considère comme essentielles pour élaborer un Spaser efficace. C’est l’une des conclusions de son mémoire labellisé "document de référence" par le Ministère de la Transition écologique (lire "Interview Yorick Guinebert : « Un Spaser efficace, c’est un outil SMART »").
Fort d’une carrière une vingtaine d'années comme directeur financier, dans les secteurs privés et publics, il a repris les études et, dans le cadre du master de performance des achats publics dispensé par l’Institut Français des Achats et de la Logistique Publics (IFALP), il analyse ce qui fait qu’un Spaser est efficace. « C'est un Spaser qui change la donne. Il doit être actionnable, mesurable et surtout partagé. »
Exercice de style : transposons allégrement ses propos à la commande publique et plus particulièrement au chantier bien engagé, en tout cas médiatiquement, de sa simplification. Objectif annoncé : simplifier pour faciliter l’accès à la commande publique aux entreprises. "Su", "Mesurable", "Accepté", "Réalisable" et "temporellement défini" ?
Première observation
Il faudrait veiller à concilier cet objectif avec ceux inscrits au frontispice du Code de la commande publique (articles L.3 et L. 3-1).
D’abord, si la transparence, l’accès à la commande publique et l’égalité de traitement sont sans aucun doute inscrits dans l’ADN de l’acheteur, les objectifs de développement durable sont sans doute appréhendés plus difficilement, car de spectre large et, par essence, évolutifs. Ce que révèlent les travaux de Yorick Guinebert, c'est que l'exercice est sans doute plus facilement atteignable à une échelle au plus proche du "terrain", c'est à dire le tissu socio-économique avec lequel l'acheteur public œuvre en partenariat.
D’abord, si la transparence, l’accès à la commande publique et l’égalité de traitement sont sans aucun doute inscrits dans l’ADN de l’acheteur, les objectifs de développement durable sont sans doute appréhendés plus difficilement, car de spectre large et, par essence, évolutifs. Ce que révèlent les travaux de Yorick Guinebert, c'est que l'exercice est sans doute plus facilement atteignable à une échelle au plus proche du "terrain", c'est à dire le tissu socio-économique avec lequel l'acheteur public œuvre en partenariat.
Deuxième observation
Ces objectifs sont-ils acceptés, au sens de "perçus" par tous ? Et de façon identique ? Rien n’est moins sûr !
Lors d’une intervention devant une assemblée d’entrepreneurs du BTP, il y a quelques mois, j’ai posé (naïvement ?) la question : « Selon vous, à quoi sert le code de la commande publique ? » « Attribuer des marchés publics aux entreprises ! » me suis-je entendu répondre, de façon aussi unanime que spontanée. Autrement dit, pour le fournisseur, l’aspect "répondre à un besoin en toute transparence en veillant à la bonne gestion des deniers publics" ne relève pas de l’évidence, loin s’en faut.
Ce décalage dans la perception de la finalité de la commande explique ainsi pourquoi des tensions naissent aussi rapidement. La mission "French Tech", et l’annonce de son académie "je choisie la French Tech" qui a pour objet de former les start-up à la commande publique, ouvrent les vannes, et en très grand, aux « anti code » sur les réseaux sociaux : "le code des marchés publics est devenu illisible et les acheteurs publics n'ont aucune idée concrète du fonctionnement des entreprises et du contenu des prestations qu'ils commandent. Ils enchaînent des phrases pseudo juridiques sans se soucier d'efficacité économique". Ou encore « Par expérience, chaque modification apportée au code des marchés publics en voulant le compliquer, créé toujours de nouvelles possibilités de le contourner. Résultat : on emmerde les entreprises tout en augmentant les risques de magouilles.»
Dans un langage Ô combien bien plus châtié, Me Pierre-Ange Zalcberg nous expliquait la semaine dernière que « Même si la simplification de l’achat public est réclamée par les entreprises, souhaitée par les acheteurs publics et invoquée par les pouvoirs publics, dans l’esprit de l’entreprise, elle n’est pas la même que celle dans l’esprit de l’acheteur public. Pour beaucoup, la simplification, c’est la dispense de publicité et de mise en concurrence… l’idée d’une dérégulation » (revoir "achatpublic invite…. Pierre-Ange Zalcberg").
Lors d’une intervention devant une assemblée d’entrepreneurs du BTP, il y a quelques mois, j’ai posé (naïvement ?) la question : « Selon vous, à quoi sert le code de la commande publique ? » « Attribuer des marchés publics aux entreprises ! » me suis-je entendu répondre, de façon aussi unanime que spontanée. Autrement dit, pour le fournisseur, l’aspect "répondre à un besoin en toute transparence en veillant à la bonne gestion des deniers publics" ne relève pas de l’évidence, loin s’en faut.
Ce décalage dans la perception de la finalité de la commande explique ainsi pourquoi des tensions naissent aussi rapidement. La mission "French Tech", et l’annonce de son académie "je choisie la French Tech" qui a pour objet de former les start-up à la commande publique, ouvrent les vannes, et en très grand, aux « anti code » sur les réseaux sociaux : "le code des marchés publics est devenu illisible et les acheteurs publics n'ont aucune idée concrète du fonctionnement des entreprises et du contenu des prestations qu'ils commandent. Ils enchaînent des phrases pseudo juridiques sans se soucier d'efficacité économique". Ou encore « Par expérience, chaque modification apportée au code des marchés publics en voulant le compliquer, créé toujours de nouvelles possibilités de le contourner. Résultat : on emmerde les entreprises tout en augmentant les risques de magouilles.»
Dans un langage Ô combien bien plus châtié, Me Pierre-Ange Zalcberg nous expliquait la semaine dernière que « Même si la simplification de l’achat public est réclamée par les entreprises, souhaitée par les acheteurs publics et invoquée par les pouvoirs publics, dans l’esprit de l’entreprise, elle n’est pas la même que celle dans l’esprit de l’acheteur public. Pour beaucoup, la simplification, c’est la dispense de publicité et de mise en concurrence… l’idée d’une dérégulation » (revoir "achatpublic invite…. Pierre-Ange Zalcberg").
Troisième observation
Concilier les deux approches de la commande publique restera toujours un délicat exercice d’équilibre pour ces pouvoirs publics… et pour l’instant s’inscrit dans un cadre dérogatoire. Dernier exemple en date, après les "régimes spéciaux" Covid ou "reconstruction en urgence des bâtiments détruit pendant les émeutes de l’été 2023", la loi de reconstruction en urgence de Mayotte (relire "Loi d’urgence pour Mayotte : les dérogations au code de la commande publique") est quand même très particulière, indépendamment de sa raison d’être qui ne se discute guère. Le législateur tente de concilier deux objectifs :
- reconstruire vite, ce qui explique les marchés globaux, l’exception au principe d’allotissement, les procédures sans publicité, avec ou sans mise en concurrence ;
- aider au redressement économique en favorisant pour la reconstruction de l’île les entreprises locales (marchés réservés, Plan de sous-traitance obligatoire...).
Des outils juridiques qui vont dans un sens opposé. Ce qui rapproche les deux séries d’outils actionnés, finalement, c’est leur côté dérogatoire au "droit commun" de la commande publique…
Quatrième et dernière observation
Ce grand écart entre simplification et respect des grands principes de la commande ne s’accommodera jamais du flou. Certaines pratiques, comme celle dite des "3 devis", montrent à quel point l’absence de cadre, au final, ne profite à aucun des objectifs visés par les uns et les autres.
Oui, les débats à propos de l’arrêt de la CAA de Nantes " Commune de Tilly-sur-Seulles " continuent et cette semaine, Jérôme Michon, s’en prend au juge : « Le vrai problème est que les magistrats ont manqué à leur devoir de vérifier si les grands principes de la commande publique s’appliquant à tout marché public, quel que soit son montant, ont été respectés » (lire "[Tribune] « L'arrêt de la CAA de Nantes sur les 3 devis ? Une vision passéiste et dépassée de la commande publique ! »").
Une décision qui, selon le Président de l’Institut de la Commande Publique et Professeur en droit des marchés publics et privés à l’ESTP, « témoigne d’une méconnaissance des subtilités actuelles de la réglementation des marchés publics ».
Alors, si même le juge perd sa boussole…
Le grand défi de la simplification de la commande publique, pour qu’elle ne se réduise pas à une pure dérèglementation, c’est-à-dire à l’abandon de ses principes fondateurs, ce sera de faire preuve de la plus grande clarté non seulement dans les moyens, mais surtout dans la définition des objectifs. Pour être partagés, ils doivent d’abord être clairement affichés...
Oui, les débats à propos de l’arrêt de la CAA de Nantes " Commune de Tilly-sur-Seulles " continuent et cette semaine, Jérôme Michon, s’en prend au juge : « Le vrai problème est que les magistrats ont manqué à leur devoir de vérifier si les grands principes de la commande publique s’appliquant à tout marché public, quel que soit son montant, ont été respectés » (lire "[Tribune] « L'arrêt de la CAA de Nantes sur les 3 devis ? Une vision passéiste et dépassée de la commande publique ! »").
Une décision qui, selon le Président de l’Institut de la Commande Publique et Professeur en droit des marchés publics et privés à l’ESTP, « témoigne d’une méconnaissance des subtilités actuelles de la réglementation des marchés publics ».
Alors, si même le juge perd sa boussole…
Le grand défi de la simplification de la commande publique, pour qu’elle ne se réduise pas à une pure dérèglementation, c’est-à-dire à l’abandon de ses principes fondateurs, ce sera de faire preuve de la plus grande clarté non seulement dans les moyens, mais surtout dans la définition des objectifs. Pour être partagés, ils doivent d’abord être clairement affichés...


Envoyer à un collègue
Offres d’emploi
Responsable de la commande publique (f/h)
- 01/07/2025
- Ville de La Teste de Buch
Responsable de la commande publique et des achats (f/h)
- 01/07/2025
- Ville de Chevilly-Larue
Juriste de la commande publique (f/h)
- 01/07/2025
- Ville de Colombes
Nouveaux documents
CAA Toulouse, 24 juin 2025, req. n° 23TL02693
-
Article réservé aux abonnés
- 01/07/25
- 01h07
TA Paris 27 mai 2025 Société Natéosanté
-
Article réservé aux abonnés
- 01/07/25
- 07h07
TA Clermont-Ferrand 20 mai 2025 SARL Entre Deux
-
Article réservé aux abonnés
- 30/06/25
- 07h06
Les plus lus
Confidentialité d’une offre rompue : la jurisprudence "Transdev" pas toujours applicable
-
Article réservé aux abonnés
- 24/06/25 06h06
- Mathieu Laugier
Quand les acheteurs publics cumulent les directions
-
Article réservé aux abonnés
- 27/06/25 06h06
- Jean-François Aubry
[Interview] La RFGP, pour« Discipliner les agents publics »
-
Article réservé aux abonnés
- 23/06/25 06h06
- Mathieu Laugier
Le plan de progrès : un outil achat au succès unanime… pour les acheteurs !
-
Article réservé aux abonnés
- 26/06/25 06h06
- Johanna Granat
Contradiction dans un DCE marché public : le candidat a sa part de responsabilité
-
Article réservé aux abonnés
- 25/06/25
- 06h06

![[Livre blanc] SPASER : Conseils, bonnes pratiques et exemples pour faire de votre SPASER un moteur de transformation](https://images.achatpublic.info/sites/default/files/field/image/event-api_spaser.png)