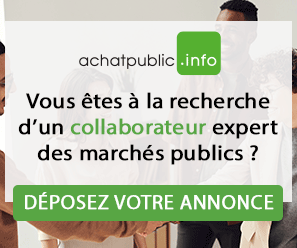Le B.A - BA de l'achat : l'appel à manifestation d'intérêt
Acheteurs issus du privé, nouveaux praticiens de l’achat, étudiants, ou acheteurs désireux de reprendre les fondamentaux de l’achat public... Le B.A BA de l’achat, c’est une série de fiches synthétiques conçues pour vous afin de faire le point sur des questions techniques de l’achat ou de (re)découvrir ensemble des notions courantes. Pour ce nouveau numéro, la rédaction se penche sur l’appel à manifestation d’intérêt.

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) est « une procédure ad’ hoc non prévue par le code de la commande publique, permettant à une personne publique de solliciter l’initiative privée pour favoriser l’émergence de projets dans lesquels elle trouve un intérêt, sans pour autant que le besoin soit parfaitement exprimé » tel que le définit la Cour régionale des comptes de Corse dans son rapport d’observations « CCI de Corse (Haute-Corse) – Concession de l’aéroport Figari Sud-Corse ».
C'est donc un processus par lequel un acheteur invite des parties intéressées à exprimer leur intérêt pour participer à un projet, une initiative ou un programme.
C'est donc un processus par lequel un acheteur invite des parties intéressées à exprimer leur intérêt pour participer à un projet, une initiative ou un programme.
Qu’est-ce qu’un appel à manifestation d’intérêt ?
L'appel à manifestation d'intérêt (AMI) est un outil clé pour les organismes publics, permettant de recueillir des idées et des solutions avant de lancer un projet, tout en favorisant la transparence et l'engagement des acteurs économiques.
Définition
L’appel à manifestation d’intérêt n’a pas de définition juridique propre dans le code de la commande publique, il s'agit d'une procédire hors code de la commande publique. Il s'agit donc d'une procédure spécifique mise en place par les organismes publics (comme l'État, les collectivités locales et les établissements publics) afin de repérer des acteurs économiques (tels que des entreprises ou des associations) qui pourraient être intéressés par un projet ou une problématique qu'ils envisagent de réaliser ou d'aborder.
L’AMI se distingue par son caractère exploratoire et non contraignant, tant pour l’émetteur que pour les répondants. Il ne constitue ni un appel d’offres, ni un engagement contractuel, mais vise à recueillir des propositions, intentions ou capacités d’acteurs potentiels, en réponse à un besoin encore en cours de définition. Ce processus est ouvert à tous les opérateurs économiques ou parties prenantes concernés par la thématique. Il repose sur une description large et indicative du projet ou du champ d’intervention, permettant une liberté d’expression des solutions, innovations ou partenariats envisageables.L’AMI se distingue par son caractère exploratoire et non contraignant, tant pour l’émetteur que pour les répondants
Objectifs
L’AMI intervient avant l’appel d’offres afin d’identifier les opérateurs économiques susceptibles de proposer une solution répondant à un besoin et d’entamer avec eux un dialogue technique ou simplement sourcer les solutions disponibles.
Cet outil utilisé par les collectivités publiques dans deux cadres différents : l’octroi de subventions ; la gestion domaniale (cession d’un bien à titre onéreux, l'attribution d'un droit d'occupation domaniale ou d'une autorisation d'urbanisme).
- Octroi de subventions : L'objectif principal semble être de réduire le caractère arbitraire de l'attribution des subventions tout en garantissant une transparence accrue dans la distribution des fonds publics. Les annonces d'AMI peuvent mettre en avant des projets prioritaires liés à la citoyenneté, à l'engagement des jeunes ou à la transition écologique.
Exemple de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » (AMI-CMA) :
S'inscrivant dans le cadre du plan d'innovation et d'industrie « France 2030 », visant à transformer durablement des secteurs clés pour positionner la France en leader de l'économie de demain, l'AMI-CMA a pour but de former 400 000 personnes par an et 1 million de diplômés d'ici 2030. Il finance des projets d'évaluation des besoins en compétences et d'initiatives pertinentes, avec un budget de deux milliards d'euros, en mettant l'accent sur la décarbonation et le numérique.
- En matière de gestion domaniale : L’AMI est peut être utilisé en matière de domanialité publique conformément à l' article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. L'idée est d'orienter la mise à disposition des propriétés publiques vers des projets bénéfiques pour les habitants de la collectivité ou son économie. Par exemple, lorsqu'une collectivité envisage de vendre une parcelle en centre-ville, elle peut opter pour un AMI afin de sélectionner un projet capable de dynamiser le commerce ou de fournir un service encore manquant à la population.
Attention, lorsque l'AMI concerne l’attribution d'une autorisation d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, il doit respecter les principes de publicité et de mise en concurrence énoncés aux articles L2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
De plus, la jurisprudence indique que "même sans texte réglementant l'appel à projets, la personne publique doit se conformer aux règles qu'elle a établies dans le cahier des charges de la consultation, ainsi qu'au principe d'égalité pour tous les candidats ayant répondu ou pouvant répondre à cet appel" (CE, 16 avril 2019, req. n° 420876).
De plus, la jurisprudence indique que "même sans texte réglementant l'appel à projets, la personne publique doit se conformer aux règles qu'elle a établies dans le cahier des charges de la consultation, ainsi qu'au principe d'égalité pour tous les candidats ayant répondu ou pouvant répondre à cet appel" (CE, 16 avril 2019, req. n° 420876).
Quelles sont les notions voisines avec lesquelles ne pas confondre l’AMI ?
Il est essentiel de bien distinguer l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) des autres dispositifs tels que l'appel à projet et l'appel d'offres, chacun ayant des objectifs et des modalités spécifiques.
L’appel à projet - L’appel à projet (APP) a pour but de sélectionner un candidat pour réaliser un projet spécifique, en se conformant à un cahier des charges détaillé. À l'inverse, l'AMI permet d'identifier plusieurs acteurs susceptibles de répondre à un besoin plus vaste et en évolution, en énonçant uniquement une problématique globale.
De plus, répondre à un AMI est souvent moins engageant que de répondre à un AAP. En effet, un candidat qui participe à un AMI n'est pas contraint de s'engager dans un marché public ultérieur et doit uniquement présenter un pré-projet.
Contrairement à l'AAP qui suit une procédure structurée et doit respecter des critères de sélection rigoureux, l'AMI présente une approche plus flexible, avec des formalités allégées.
L’appel d’offres - L'appel d'offres (AO) vise à établir un contrat de prestation entre un organisme public ou une entité soumise au code de la commande publique et un prestataire, contrairement à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI), qui permet aux entités publiques de sonder le marché et d'identifier des entreprises. L'AO comprend un cahier des charges détaillant la prestation à réaliser.
Cette procédure de sélection publique est obligatoire au-delà d'un certain montant pour la réalisation de travaux, de fournitures ou de services.
Comment répondre à un appel à manifestation d’intérêt ?
L'appel à manifestation d'intérêt est une procédure « sui generis » qui n'est ni clairement définie ni réglementée par des textes spécifiques. Cependant, cette absence de réglementation ne signifie pas qu'il n'existe pas de contraintes dans le processus de sélection préalable.
L'avis de pré-information -Pour cette première étape, l’acheteur lance un AMI par le biais d’un avis de pré-information, qui fait office d'avis de publicité, afin d'inviter les candidats à exprimer leur intérêt pour le marché identifié. Dans ce document, l'acheteur public présente un cadre général, des objectifs et une thématique, visant à susciter des initiatives privées apportant des réponses pertinentes à des enjeux d'intérêt général. Cette démarche permet également de favoriser l'innovation et de mobiliser des ressources variées pour répondre aux besoins identifiés.
Le dossier de réponse - Le contenu d'un dossier de réponse à un AMI peut varier selon l'organisme public et le projet concerné, mais il comprend généralement plusieurs éléments clés.
Tout d'abord, le candidat doit se présenter en mettant en avant ses compétences et son expertise en lien avec le projet.
Ensuite, il exprime clairement son intérêt pour le projet et explique ses motivations. Le candidat peut également proposer des solutions innovantes, des idées de montage de projet ou des pistes de réflexion en rapport avec la problématique posée. De plus, il est possible d'inclure des informations complémentaires telles que des références, des plaquettes de présentation ou des lettres de motivation. Il est essentiel de se référer attentivement à l'avis de publication de l'AMI pour connaître les éléments spécifiques attendus dans le dossier de réponse.
La sélection des candidatures -L'acheteur peut à présent présélectionner des candidats pour les prochaines procédures de passation de marchés publics. Ceux retenus sont ensuite invités à soumissionner lors d'appels d'offres.
Sur le même sujet


Envoyer à un collègue
Offres d’emploi
Juriste conseil et contentieux de la commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Département des Hauts-de-Seine
Juriste affaires générales et achats publics (f/h)
- 02/09/2025
- Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
Responsable finances et commande publique (f/h)
- 02/09/2025
- Ville du Pellerin
Nouveaux documents
TA Nancy 3 juillet 2025 Sociétés Muller TP et NGE Paysages
-
Article réservé aux abonnés
- 08/09/25
- 07h09
TA Cergy-Pontoise 2 juillet 2025 Société Le Vigilant Sécurité Privée
-
Article réservé aux abonnés
- 05/09/25
- 07h09
TUE 23 juillet 2025 BT Global Services Belgium
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25
- 07h09
Les plus lus
Validation d’un critère environnemental évaluant la politique générale des candidats à un marché public
-
Article réservé aux abonnés
- 02/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Attributaire déchu d’un marché public : le classement des soumissionnaires à revoir ?
-
Article réservé aux abonnés
- 04/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Acheteur public : un métier sous tensions, selon la Commission d’enquête du Sénat
-
Article réservé aux abonnés
- 03/09/25 06h09
- Jean-Marc Joannès
[Interview] - Laurent Dutertre : «L’IA n’est pas prête de remplacer l’acheteur»
-
Article réservé aux abonnés
- 01/09/25 06h09
- Johanna Granat