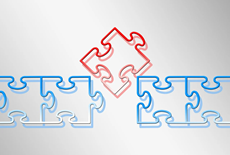Lâcher de critères RSE et effet boomerang
Editos
- 01/03/2021
« Les vrais besoins n'ont jamais d'excès »
Jean-Jacques Rousseau
Il arrive parfois qu’un juge adopte une solution de manière à ce qu’en cassation, la juridiction suprême "fixe" définitivement une ligne jurisprudentielle. C’est peut être bien ce mécanisme qui sous-tend la décision du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2021 "Sophia groupe" (lire "Egalité des chances, lutte contre le harcèlement, bien-être au travail… les nouveaux critères des offres").
Jean-Jacques Rousseau
Il arrive parfois qu’un juge adopte une solution de manière à ce qu’en cassation, la juridiction suprême "fixe" définitivement une ligne jurisprudentielle. C’est peut être bien ce mécanisme qui sous-tend la décision du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2021 "Sophia groupe" (lire "Egalité des chances, lutte contre le harcèlement, bien-être au travail… les nouveaux critères des offres").
Libération
Le TUE y assène quelques formules fortes. Par exemple « Il ne saurait être exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre au regard du pouvoir adjudicateur ». Autrement dit, et en deux points articulés :
1- le pouvoir adjudicateur est juridiquement libre dans l’objet son acte d’achat ;
2- il peut donc décider d’affecter à son achat une valeur autre qu’économique.
Ce n’est pas jeter aux oubliettes les principes de définition préalable des besoins et de bonne gestion des deniers publics. C’est affirmer que tout en respectant ces deux principes, il est libre de définir "politiquement", au sens noble de terme, la nature du besoin qu’il estime devoir satisfaire : les moyens deviennet aussi l'objectif. C’est aussi tourner en boucle le principe jurisprudentiel selon lequel les critères d’attribution doivent rester en lien avec l’objet du marché.
Avec un risque contentieux minimum selon le TUE, qui rappelle que si le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des critères d’attribution, l’office du juge se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Et donc, en l’espèce, le juge ne pouvait qu’apprécier "techniquement' le recours à des critères tournés vers la diversité et l’égalité des chances, la lutte contre le harcèlement, l’inclusion de personnes en situation de handicap, et le bien-être au travail.
Le message : "le pouvoir adjudicateur peut utiliser tous les critères qu’il souhaite, s’il le fait correctement ".
1- le pouvoir adjudicateur est juridiquement libre dans l’objet son acte d’achat ;
2- il peut donc décider d’affecter à son achat une valeur autre qu’économique.
Ce n’est pas jeter aux oubliettes les principes de définition préalable des besoins et de bonne gestion des deniers publics. C’est affirmer que tout en respectant ces deux principes, il est libre de définir "politiquement", au sens noble de terme, la nature du besoin qu’il estime devoir satisfaire : les moyens deviennet aussi l'objectif. C’est aussi tourner en boucle le principe jurisprudentiel selon lequel les critères d’attribution doivent rester en lien avec l’objet du marché.
Avec un risque contentieux minimum selon le TUE, qui rappelle que si le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix des critères d’attribution, l’office du juge se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Et donc, en l’espèce, le juge ne pouvait qu’apprécier "techniquement' le recours à des critères tournés vers la diversité et l’égalité des chances, la lutte contre le harcèlement, l’inclusion de personnes en situation de handicap, et le bien-être au travail.
Le message : "le pouvoir adjudicateur peut utiliser tous les critères qu’il souhaite, s’il le fait correctement ".
Poussées contraires
C’est ouvrir largement la porte à l’adoption de tous les critères RSE imaginables, alors que les acheteurs, même les plus audacieux, avaient vécu comme un coup de frein l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 mai 2018 "Nantes Métropole" (relire "L’interdiction du critère RSE est-elle logique ?"). La décision "Sophia groupe" a de quoi alimenter la poussée en faveur des critères RSE (consulter notre dossier "Critères RSE : vers un retour en force ?"). Désormais, les outils sont là : le CD2E, association des Hauts-de-France, met par exemple en ligne gratuitement des clauses de développement durable, à destination des collectivités publiques, afin qu’elles puissent les insérer dans leurs marchés publics (relire "Clauses vertes : faites votre marché !").
Si cela frotte encore, ce n'est passur le principe d’insertion de critères RSE, mais sur la « faisabilité ». On relira avec intérêt l’interview de Matthieu Belayer ("Il ne faut pas que la mise en place d’une clause environnementale devienne un « casse-tête » pour l’acheteur "). Le chargé de mission de la dynamique « Achats publics durables » au Reséco s’interroge : « Est-il pertinent d’imposer une clause environnementale dans des marchés publics qui ne s’y prêtent pas toujours ? »
Dans la même veine, et à propos de l’obligation d’insertion d’une clause environnementale dans les marchés (une des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat), Jacques Fourier de Laurrière est circonspect : « Sur une gamme très large de marchés, cela va être difficile de trouver un critère environnemental. Il ne suffit pas de déclarer obligatoire un critère : il faut être en mesure de le définir ! » (relire "Une clause environnementale obligatoire ? C’est risqué, de vouloir inscrire une pétition de principe dans le code ! ")
Imposer un critère environnemental, cela pourrait complexifier le travail des donneurs d’ordre comme des entreprises. Et pourtant, il semble bien que le "Gouvernement-législateur-citoyen-de-la conventionClimat", dans le cadre du projet de loi "Climat et résilience", ne s’attarde pas sur ces considérations de terrain, en imposant, en l’état du texte, qu’au moins un des critères de sélection prenne en compte «les caractéristiques environnementales de l’offre » (relire "Projet de loi Climat et résilience : et donc, la fin du critère unique du prix") .
Parmi les arguments s'opposant à l’extension sans limite des clauses RSE, l'un pourrait prospérer : l’acheteur ne peut être juge de la politique de l’entreprise. Sous-entendu, une telle appréciation serait contraire à la règle de critères d’attribution objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.
Si cela frotte encore, ce n'est passur le principe d’insertion de critères RSE, mais sur la « faisabilité ». On relira avec intérêt l’interview de Matthieu Belayer ("Il ne faut pas que la mise en place d’une clause environnementale devienne un « casse-tête » pour l’acheteur "). Le chargé de mission de la dynamique « Achats publics durables » au Reséco s’interroge : « Est-il pertinent d’imposer une clause environnementale dans des marchés publics qui ne s’y prêtent pas toujours ? »
Dans la même veine, et à propos de l’obligation d’insertion d’une clause environnementale dans les marchés (une des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat), Jacques Fourier de Laurrière est circonspect : « Sur une gamme très large de marchés, cela va être difficile de trouver un critère environnemental. Il ne suffit pas de déclarer obligatoire un critère : il faut être en mesure de le définir ! » (relire "Une clause environnementale obligatoire ? C’est risqué, de vouloir inscrire une pétition de principe dans le code ! ")
Imposer un critère environnemental, cela pourrait complexifier le travail des donneurs d’ordre comme des entreprises. Et pourtant, il semble bien que le "Gouvernement-législateur-citoyen-de-la conventionClimat", dans le cadre du projet de loi "Climat et résilience", ne s’attarde pas sur ces considérations de terrain, en imposant, en l’état du texte, qu’au moins un des critères de sélection prenne en compte «les caractéristiques environnementales de l’offre » (relire "Projet de loi Climat et résilience : et donc, la fin du critère unique du prix") .
Parmi les arguments s'opposant à l’extension sans limite des clauses RSE, l'un pourrait prospérer : l’acheteur ne peut être juge de la politique de l’entreprise. Sous-entendu, une telle appréciation serait contraire à la règle de critères d’attribution objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.
Le risque d’aller trop loin... ou pas assez
C’est aussi sur cette frontière entre mode de fonctionnement de l’entreprise et conditions d’exécution du marché que portent tous les débats (en commande publique, s’entend…) sur "la clause républicaine". Le projet de loi confortant le respect des principes de la République, que le Sénat examinera le 30 mars, pose "LA" question : les administrations doivent-elles imposer à leurs prestataires que leurs salariés respectent le principe de neutralité auquel est assujetti tout agent public ?
Samuel Dyens a ce qu’on appelle une opinion "balancée": il relève d'une part que les collectivités publiques, et notamment les services achats, ne sont pas nécessairement au fait des enjeux de neutralité des salariés de leurs (futurs) prestataires. Il rappelle d'autre part que si le législateur entend étendre le régime applicable aux agents aux prestataires des marchés publics, il faut garder en tête que « L’agent public n’a pas à être un promoteur de la laïcité ; il a l’obligation de respecter la neutralité ». L’avocat s’interroge aussi : « un marché public donne les moyens à l’administration d’exercer ses missions. Est-ce suffisant pour considérer, par principe, que l’opérateur participe à un service public ? » (lire "Vers une neutralité politique et religieuse à l’égard des salariés du titulaire d’un marché public ?").
Enfin, il faudra voir ce qu'en fera le juge. Puisque l’on parle d’égalité femmes hommes dans l’affaire "Sophia groupe", on ne peut que constater une certaine frilosité du juge, en tout cas national, qui s’abrite et protège les entreprises au nom du "secret des affaires" (relire "Exclusion d'une candidature et name & shame : on y est pas encore !" et "L’égalité homme femme, un nouveau chantier pour la commande publique").
Samuel Dyens a ce qu’on appelle une opinion "balancée": il relève d'une part que les collectivités publiques, et notamment les services achats, ne sont pas nécessairement au fait des enjeux de neutralité des salariés de leurs (futurs) prestataires. Il rappelle d'autre part que si le législateur entend étendre le régime applicable aux agents aux prestataires des marchés publics, il faut garder en tête que « L’agent public n’a pas à être un promoteur de la laïcité ; il a l’obligation de respecter la neutralité ». L’avocat s’interroge aussi : « un marché public donne les moyens à l’administration d’exercer ses missions. Est-ce suffisant pour considérer, par principe, que l’opérateur participe à un service public ? » (lire "Vers une neutralité politique et religieuse à l’égard des salariés du titulaire d’un marché public ?").
Enfin, il faudra voir ce qu'en fera le juge. Puisque l’on parle d’égalité femmes hommes dans l’affaire "Sophia groupe", on ne peut que constater une certaine frilosité du juge, en tout cas national, qui s’abrite et protège les entreprises au nom du "secret des affaires" (relire "Exclusion d'une candidature et name & shame : on y est pas encore !" et "L’égalité homme femme, un nouveau chantier pour la commande publique").
Vertige et équilibre
Finalement, il y a quand même une unité, dans toutes ces considérations, poussées contraires, volonté politique et contraintes de terrain. Faire de la commande publique un levier au soutien de l’économie mais aussi de toutes les politiques sociales, environnementales et sociétales, cela inquiète les acheteurs (relire "Qui trop embrasse mal étreint, ou les dangers d’une instrumentalisation abusive de l’achat public").
Mais les acheteurs pourraient ne pas être les seuls à éprouver les vertiges d'une liberté sans limite des critères RSE. Car l'inévitable contrepartie, ou effet boomerang, c’est que cela légitime fortement par là-même l’immixtion du pouvoir adjudicateur dans le mode de fonctionnement des entreprises.
A nouveau, il y a un équilibre à trouver….
Mais les acheteurs pourraient ne pas être les seuls à éprouver les vertiges d'une liberté sans limite des critères RSE. Car l'inévitable contrepartie, ou effet boomerang, c’est que cela légitime fortement par là-même l’immixtion du pouvoir adjudicateur dans le mode de fonctionnement des entreprises.
A nouveau, il y a un équilibre à trouver….
Jean-Marc Joannès


Envoyer à un collègue
Offres d’emploi
Acheteur marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
Gestionnaire marchés publics (f/h)
- 11/09/2025
- CETIM - Centre Technique des Industries Mécanique
- 10/09/2025
- Ville d'Argenteuil
Nouveaux documents
[Dessine-moi la commande publique] : Variante et Prestation supplémentaire éventuelle (2/2)
-
Article réservé aux abonnés
- 15/09/25
- 04h09
[Dessine-moi la commande publique] Variante et Prestation supplémentaire éventuelle (1/2)
-
Article réservé aux abonnés
- 15/09/25
- 04h09
TA Paris 17 juillet 2025 Société Prestibat
-
Article réservé aux abonnés
- 15/09/25
- 07h09
Les plus lus
Marché public : une offre incomplète n’est pas systématiquement irrégulière
-
Article réservé aux abonnés
- 11/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
Candidature de plusieurs filiales à un marché public : l’autonomie commerciale contestée
-
Article réservé aux abonnés
- 08/09/25 06h09
- Mathieu Laugier
[Au plus près des TA] Quand la CAA s’intéresse à la déclaration sans suite
-
Article réservé aux abonnés
- 09/09/25 06h09
- Nicolas Lafay
Marché public de faible montant : pas d’exception à la computation des seuils
-
Article réservé aux abonnés
- 08/09/25
- 06h09
Marché public : un candidat admissible à la négociation... évincé
-
Article réservé aux abonnés
- 12/09/25
- 06h09

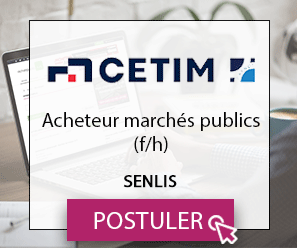
![[Livre blanc] La computation des seuils : les bonnes pratiques et pièges à éviter](https://images.achatpublic.info/sites/default/files/field/image/pave-api_computation-seuils.png)